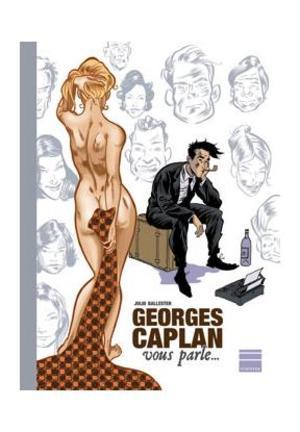« Je vis parmi les poètes, les lesbiennes, les peintres
et les musiciens, les troubadours et leurs guitares, les alcooliques et les
drogués, les putes et les fous. En pleine décadence, quoi. L’abolition du
bourgeois. L’enfer ». A lire le texte de la quatrième de couv’ du dernier
roman de Pedro Juan Gutiérrez publié en France (Albin Michel), Le Nid du
Serpent, on trouve assez logique que l’écrivain cubain donne rendez-vous
dans un bar de la place Pigalle, entre un peep-show et un sex-shop.
« Je vis parmi les poètes, les lesbiennes, les peintres
et les musiciens, les troubadours et leurs guitares, les alcooliques et les
drogués, les putes et les fous. En pleine décadence, quoi. L’abolition du
bourgeois. L’enfer ». A lire le texte de la quatrième de couv’ du dernier
roman de Pedro Juan Gutiérrez publié en France (Albin Michel), Le Nid du
Serpent, on trouve assez logique que l’écrivain cubain donne rendez-vous
dans un bar de la place Pigalle, entre un peep-show et un sex-shop.
Je devais depuis longtemps lui donner des exemplaires de
L’Amateur de Cigare de janvier-février 2007, où figure l’interview que j’avais
faite de lui, en juin 2006, à La Havane. La manière dont il avait parlé des
cigares de consumo nacional, ceux de la rue, m’avait fait envisager mon
goût pour le havane sous un angle neuf : non, il n’y a pas que Cohiba et
Partagas. Non, on n’est pas obligé d’ouvrir les entrailles de son puro
pour lui demander de décliner sa palette aromatique. Face à un moment
d’exception, le silence est parfois le meilleur des compliments.
Cet été, la promo du Nid du Serpent l’a conduit à
Madrid, puis à Paris. Un e-mail, suivi d’un coup de fil chez l’ami qui l’héberge,
boulevard de Clichy. Rendez-vous est pris, ce jeudi 9 août, avec celui qu’on
surnomme le Bukowski des Caraïbes.
Le Nid du Serpent, c’est la suite des
tribulations de votre double, Pedro Juan ?
Oui. Je voulais terminer le "cycle de Centro Habana", composé
de cinq livres : La Trilogie sale de la Havane, Le Roi de la Havane,
Animal Tropical, El Insaciable Hombre Arana et Carne de Perro, les
deux derniers n’étant pas encore publiés en France. J’ai eu envie d’écrire sur
Pedro Juan jeune, à dix-sept, dix-huit ans. Le prélude au héros violent,
hypersexuel, un peu fou de La Trilogie sale de la Havane. Cela donne un
livre de souvenirs assez autobiographique. Il s’achève avec Pedro Juan sortant
du service militaire. Il plaque sa nana, il ne sait pas ce qu’il veut, il est
bourré, se lève et part dans la nuit. Et ça finit sur cette phrase : «Il
fallait continuer à avancer, avancer à travers la furie et l’horreur ».
Points de suspension. Ce qui a excité mon éditeur italien au plus haut
point : il est convaincu qu’on va continuer à suivre l’apprentissage de
Pedro Juan…
Et donc ?
J’écris effectivement la suite, par petits bouts. Même ici,
à Paris. Mais j’ai un vrai problème avec l’écriture. Quand je commence un roman,
ce n’est pas comme un poème. Je tourne autour. Quand j’ai enfin commencé, ça me
prend quatre à cinq mois.
Vous n’aimez pas évoquer publiquement la situation
politique à Cuba. Pourtant, avec Le Nid…, vous décrivez sans fard l’effondrement
du rêve révolutionnaire…
J’avais besoin d’écrire sur les années 70 à Cuba. Pour nous, elles ont autant compté que votre Mai 68, ou que le Flower Power américain.
L’abolition de la propriété privée, la violence, l'absurdité du service militaire, la diaspora – un million de
cubains vivent aujourd’hui à Miami, 40 000 à Paris… Le Nid… donne
une approximation romancée de tout cela. Au début, mon texte était trop
politique, presque une analyse. Peut-être parce que j’ai été journaliste
pendant 26 ans. J’ai retravaillé cette première version. Maintenant ça
fonctionne. Il y a plus de politique et moins de fiction.
Que reste-t-il du Pedro Juan de cette époque ?
Je dirai qu’il en reste un peu trop ! Il est devenu
plus mûr, plus serein. A 57 ans, je suis toujours impulsif, je deviens à moitié
fou quand je vois une femme qui me plaît (à la fin de cette interview,
l’écrivain prendra congé pour aller retrouver « une amie
brésilienne »… NdA). Hier, à l’aéroport de Madrid, je suis passé à la
librairie. Je me retrouve avec un bouquin dans les mains, intitulé Vieillir
avec sagesse. (rires). Je l’ai reposé. Cela manquera peut-être à ma
culture, mais faut pas pousser…
Gardez-vous l’espoir d’être publié à Cuba de votre
vivant ?
Là-bas, mes livres ont une couleur encore trop politique.
Seuls trois textes sont tolérés, La Mélancolie des Lions, Animal Tropical
et une nouvelle policière. Ils sont tellement passés au tamis avant d’être
publiés qu’ils en sont devenus squelettiques. Ailleurs, comme en Espagne, en
Italie, en France, où on les achète avant tout pour le sexe débridé, le lobby
en ma faveur grandit. Editeurs, journalistes, m’aident chaque jour davantage.
C’est bon pour moi. J’ai plus que jamais l’espoir de feuilleter un jour mes
livres à La Havane.
Le Nid du Serpent, Pedro Juan Guttiérez, Ed. Albin Michel, 19,50 euros.
www.pedrojuangutierrez.com
(Photos : B. Wagner)